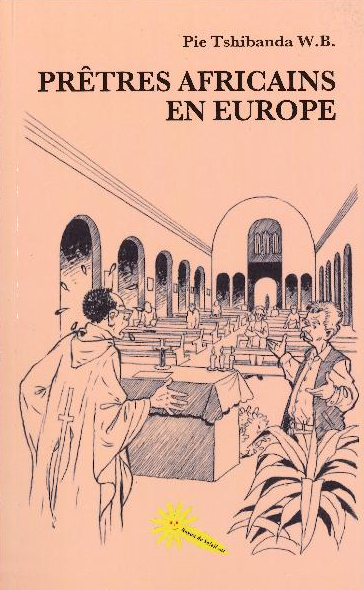
Pie TSHIBANDA W. B.
Prêtre africains en Europe
Disponible à l’UOPC
–
Pour aborder la situation que soulève directement le titre du livre, il est intéressant d’avoir le point de vue de Pie Tshibanda.
Connu pour ses seuls-en-scène en Belgique sur le choc des cultures occidentale et subsaharienne, à partir de son expérience, ce comédien – formé à la psychologie – a décidé de passer à l’écriture pour aborder ce choc dans le domaine religieux…
Ainsi, nous suivons dans ce récit les aventures d’Alphonse, prêtre venu d’Afrique en Europe à la demande de son évêque pour « répondre à cet appel de l’Église catholique en Europe » et « aller leur rappeler l’Evangile ». Il ne connaît rien à la situation en Occident et obéit de mauvaise grâce, tant il lui coûte de laisser ses nombreuses initiative lancées dans sa paroisse. La question se pose donc en ces termes : quelles réactions l’Europe a-t-elle face à un prêtre cultivé, compétent, désintéressé, mais ignorant son évolution récente ?
En dix chapitres, Pie Tshibanda fait le catalogue de nombreuses situations où le prêtre africain se trouve à devoir s’adapter à des usages inconnus de lui. Ce point de vue décentré, nouvelle version des « Lettres persanes » appliquée à la religion, est souvent très intéressant.
Une partie de ces situations recoupe les spectacles précédents de notre comédien : elles tiennent à l’opposition entre une Europe individualiste et une Afrique très soucieuse des liens communautaires. La place des personnes âgées est fondamentalement différente dans les deux cultures et la solidarité dans un même village aussi. On sent bien que le délitement des liens sociaux en Europe suscite la réprobation de Pie Tshibanda.
Le gros du récit est cependant consacré à l’opposition entre deux formes de christianisme. En effet, comme le résume bien l’auteur, le christianisme africain n’a pas connu de « mai 68 ». Le prêtre en Afrique est perçu comme un véritable notable, autorité respectée, détenteur (exclusif ?) de l’intégralité du message évangélique. Alphonse, dans le récit, apprend à se défaire de cet aspect de sa fonction (et à raccourcir ses sermons !) pour mieux rentrer en communication avec ses paroissiens. C’est aussi un animateur acharné de la vie de sa paroisse, toujours à la recherche de manières différentes d’attirer les gens à l’église.
Là où les choses coincent vraiment, c’est dans le domaine éthique. Le relativisme occidental se heurte de front à une morale « traditionnelle » prêchée par le clerc africain. Ce d’autant que le clerc en question n’a pas vécu, dans son pays d’origine, les affaires de crimes sexuels sur mineurs que l’Europe a connu.
Cette question des prescriptions morales est d’ailleurs une sorte de « point aveugle » du livre : tout se passe comme si les chrétiens africains et leurs prêtres étaient parfaitement respectueux de la morale catholique la plus rigoriste, tant dans leurs discours que dans leurs actes. Est-ce crédible ? Ce qui est par contre bien relevé, c’est la scission entre le sentiment d’être chrétien de bon nombre de jeunes occidentaux et la pratique effective de la partie morale de cette religion.
Le chapitre final aborde de front la question de l’opposition – laïque – à la mission des prêtres africains (ou étrangers) en Europe occidentale. L’argument principal de ces opposants est que la solution à la crise des vocations en Europe se trouve dans l’ordination d’hommes – ou de femmes – mariés. Ce à quoi il est répondu que les protestants, qui ont cette discipline, ont les mêmes problèmes de vocation, et que les travail des prêtres africains porte des fruits en terme de fréquentation des églises. Pie Tshibanda laisse la conclusion ouverte et en appelle à un nouveau synode…

